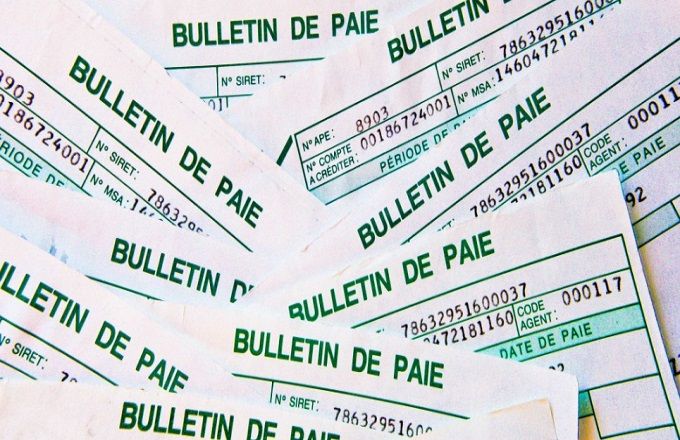Réformer les salaires pour reconstruire l’État
Le salaire, dans son essence historique et économique, est un instrument central du système capitaliste. Il a été conçu non seulement pour rémunérer le travail, mais surtout pour permettre au capitalisme de se reproduire, d’assurer la pérennité de l’ordre économique établi et d’organiser la vie en société autour des rapports de production.
En régime capitaliste, le salaire fonctionne comme un mécanisme de régulation sociale : il rémunère les forces de travail tout en maintenant une hiérarchie économique favorable à l’accumulation du capital.
À l’opposé, dans la théorie communiste, le salaire tel que conçu dans le capitalisme est remis en question, voire aboli. Le principe fondamental ici repose sur l’idée que la valeur humaine ne peut être réduite à un prix. Aucun facteur de production, y compris le travail, ne saurait produire une richesse supérieure à sa propre valeur sans que cela ne traduise une exploitation. Le profit (ou surplus) réalisé dans ce système est alors considéré comme le fruit du travail collectif, et ne devrait donc pas revenir exclusivement à ceux qui détiennent les moyens de production, mais à la collectivité dans son ensemble.
Ainsi, dans cette perspective, le travail humain est inestimable et ne saurait être traité comme une marchandise. Cela pose des questions éthiques et philosophiques sur la nature même du travail, de la dignité humaine et de la justice sociale dans nos sociétés modernes.
En RDC, la situation du travail rémunéré révèle une profonde crise systémique, tant sur le plan économique que social.
La rémunération du travail est largement symbolique pour une grande majorité de prestataires. Le phénomène de « modicité salariale » s’est progressivement institutionnalisé, au point de devenir un mode d’organisation considéré comme « normal ». L’accès à un « salaire décent » relève presque de l’exception : réservé à une élite politique, aux dirigeants de grandes entreprises privées ou aux employés d’organisations internationales.
Dans la fonction publique, l’emploi est souvent assimilé à un statut social plus qu’à une réelle activité économique productive. Le « salaire » y est fréquemment remplacé par des « allocations professionnelles » (transport, lunch, prime de présence…), qui ne constituent ni un revenu stable ni suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux. La conséquence directe est l’impossibilité pour la majorité des agents publics de constituer une épargne, ou même d’assurer une consommation minimale.
Ce dérèglement du rapport au travail pousse les individus à s’engager dans la débrouillardise, parfois au mépris de l’éthique professionnelle. Les structures de régulation, de contrôle du travail et de justice sociale sont presque inexistantes ou dysfonctionnelles, laissant place à une forme de démence organisationnelle où chacun lutte pour sa propre survie.
Dans le secteur agricole, la problématique est encore plus flagrante : dans la comptabilité des exploitations, la main-d’œuvre est souvent exclue ou mal évaluée, faussant ainsi les résultats d’exploitation. Cette sous-valorisation du travail manuel s’observe également dans de nombreuses activités libérales ou artisanales, réduites à de simples mécanismes de subsistance.
Le besoin naturel de travailler, qui devrait être un moteur de développement personnel et collectif, tend à être supplanté par un attrait croissant pour les loisirs, la religion ou l’oisiveté. Ce glissement de valeurs traduit une forme de chômage déguisé, entretenue par une société où le travail ne garantit plus la dignité ni la sécurité sociale. L’effort créatif s’efface au profit d’une attente passive d’opportunités, souvent politiques.
Le résultat est un déséquilibre où la politique devient le principal refuge des ambitions individuelles, non pas pour servir l’intérêt général, mais pour échapper à la précarité des autres formes d’emploi.
Cette fuite vers la politique s’explique largement par l’absence de repères dans la politique salariale nationale. Dans ce contexte, les inégalités de rémunération ne sont pas seulement injustes : elles sont devenues la matrice du désordre social. Il est désormais « normal » qu’une minorité concentrée autour des centres de pouvoir s’octroie des rémunérations extravagantes et des privilèges excessifs, pendant que la majorité des travailleurs peine à satisfaire ses besoins les plus élémentaires.
Si une réforme courageuse et équitable de la politique salariale n’est pas entreprise rapidement, cette situation, qui semble aujourd’hui bénéficier à certains, risque de devenir un facteur explosif dans un avenir proche. Le ressentiment social grandissant, nourri par une injustice économique flagrante, pourrait engendrer des tensions capables de compromettre la cohésion nationale et la stabilité du pays.
Il est donc urgent de repenser le modèle de fixation des salaires et des avantages*, non seulement comme une question économique, mais surtout comme *un impératif éthique, social et politique* pour garantir un avenir viable et inclusif à la nation congolaise.
En somme, le travail en RDC est *dévalorisé, déconnecté de sa fonction économique* et vidé de sa dimension émancipatrice. Pour y remédier, il est impératif de *repenser la politique salariale nationale*, de *revaloriser la fonction productive*, et de *réactiver les mécanismes de contrôle et de justice sociale* dans le monde du travail.
En RDC, les salaires sont fixés par plusieurs mécanismes, selon le secteur (public ou privé) et l’institution concernée :
1. Qui fixe les salaires ?
– Fonction publique : Les salaires sont fixés par décrets, arrêtés ministériels ou lois budgétaires, avec l’avis du ministère de la Fonction publique et du Budget.
– Entreprises publiques : Les conseils d’administration, sous tutelle de l’État, fixent les grilles salariales. Mais il y a souvent opacité et clientélisme.
– Secteur privé : Fixation par contrat entre employeur et employé, dans le respect du SMIG (Salaire minimum interprofessionnel garanti) fixé par l’État.
2. Pourquoi des inégalités salariales ?
– Absence de transparence dans la gestion des ressources humaines.
– Faiblesse des syndicats ou leur compromission.
– Clientélisme, népotisme et favoritisme dans les nominations et traitements.
– Absence de politiques salariales unifiées ou de contrôle effectif par les organes compétents (IGF, Cour des comptes, etc.).
– Les salaires très élevés (ex. 50.000 $) sont souvent réservés aux hauts cadres nommés politiquement, sans rapport réel avec la productivité ou les qualifications.
– La valeur du travail réel n’est pas prise en compte dans beaucoup d’institutions publiques.
3. Comment cela fonctionne dans d’autres pays ?
– Transparence salariale : Les grilles salariales sont publiques.
– Équité salariale : Des lois imposent un écart salarial maximum entre dirigeants et employés (ex. 1:10, 1:15 dans certaines entreprises publiques).
– Évaluation des postes : Les salaires sont fixés selon le *niveau de responsabilité, la compétence, l’expérience et les résultats.
– Négociation collective : Les syndicats puissants négocient régulièrement les augmentations.
– Audit et contrôle : Les écarts injustifiés peuvent être sanctionnés.
Conclusion
Le système salarial en RDC est « largement déséquilibré, injuste et peu régulé », contrairement à ce qu’on observe dans des systèmes plus institutionnalisés. Ce n’est ni normal ni soutenable, et une réforme profonde de la politique de rémunération publique est urgente pour rétablir la justice sociale et la performance.
La RDC a effectivement besoin d’un mécanisme solide pour garantir une politique salariale équitable et cohérente à travers les secteurs.
Solution recommandée
Créer un « Conseil National de l’Équité Salariale et de la Rémunération Publique », une autorité administrative indépendante, avec :
– Une base légale claire, votée par le Parlement.
– Une représentation large : État, employeurs, syndicats et sociétés civiles.
– Des missions précises : régulation, harmonisation, contrôle, veille stratégique.
Ce Conseil travaillerait en lien avec la Fonction publique, le Budget et le Travail, mais avec un pouvoir consultatif fort et une autorité morale et technique reconnue.
Objectif : Assurer une répartition juste de la richesse nationale, restaurer la dignité des travailleurs et réduire les inégalités sociales qui fragilisent la paix et le développement.
Sans justice salariale, il n’y aura ni stabilité, ni performance, ni patriotisme économique durable.
Luc Alouma M.