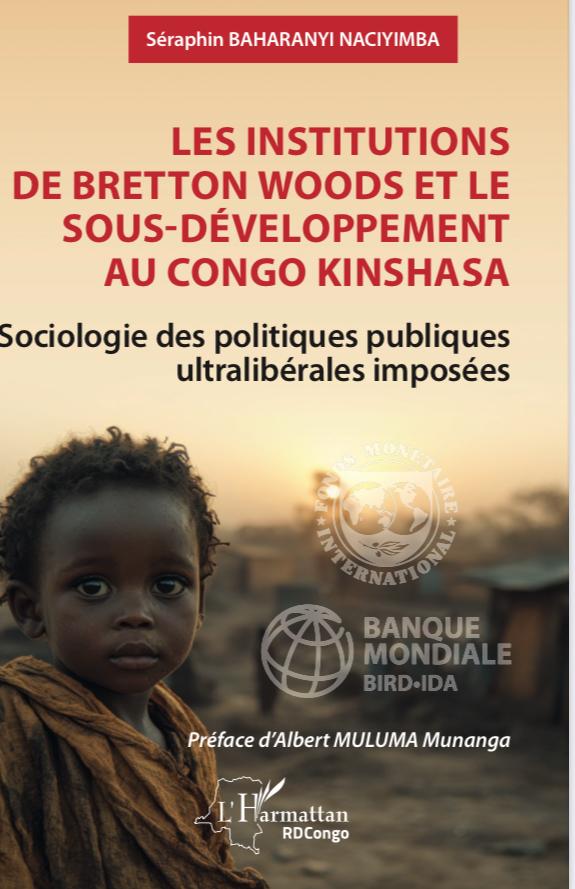Le vernissage de cet ouvrage a eu lieu le 3 novembre 2025 au CEPAS à Kinshasa.
Par le Professeur Claude SUMATA
- Introduction
Révérend Père Provincial, Révérends Pères, Révérendes Sœurs, Honorables, Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, Distingués représentants du corps diplomatique et des Institutions financières internationales, Éminents professeurs, chers collègues, chers amis,
Je vous souhaite la bienvenue à la présentation d’un ouvrage qui risque de provoquer les sourires des uns et heureusement la réflexion de beaucoup… et peut-être déranger la conscience de quelques-uns. Son titre annonce la couleur : « Les Institutions de Bretton Woods et le sous-développement au Congo-Kinshasa : Sociologie des politiques publiques ultralibérales imposées ».
En fait, ce livre pose la question que tout Congolais se pose en silence :
Comment se fait-il que, malgré tous les plans Mobutu et autres objectifs 80, les programmes d’ajustements structurels et leurs conditionnalités, les DSRP, OMD, ODD, les séminaires- ateliers, les tableaux avec leurs “visions 2030-2040-2050”, la population congolaise ait encore l’impression que le développement prend le bus… mais qu’on ne sait jamais à quel arrêt il descend ?
A rebours des discours triomphants souvent relayés au niveau international, des communiqués et effets d’annonce, l’auteur pose un diagnostic lucide : les politiques publiques inspirées — pour ne pas dire imposées — par les Institutions de Bretton Woods produisent des résultats contrastés, parfois mitigés, souvent désastreux sur le terrain social.
Cet ouvrage invite donc à un débat responsable, documenté et constructif. Il ne s’agit pas d’un réquisitoire idéologique, mais d’une analyse sociologique rigoureuse, ouverte au dialogue — un dialogue que nous espérons entamer ici même, en présence de celles et ceux qui, chacun à leur niveau, participent à la formulation, à la mise en œuvre ou à l’évaluation hypothétique des politiques publiques en RDC.
- Contenu de l’ouvrage
L’ouvrage se déploie sur six chapitres répartis en deux grandes parties.
La première partie pose les fondations théoriques de l’analyse : l’auteur y expose le paradigme qui soutient sa lecture des faits, structuré en trois chapitres essentiels.
Le premier se consacre à l’élucidation des concepts opératoires mobilisés par la problématique de l’étude et aux hypothèses sous-jacentes. Cette étape vise à clarifier le sens sociologique des notions centrales et à poser les bases conceptuelles nécessaires pour interpréter les phénomènes observés. En articulant théorie et opérationnalisation, l’auteur établit les fondements analytiques permettant de situer la recherche dans le champ scientifique de la sociologie des politiques publiques.
Le second fixe le cadre théorique qu’il estime le plus pertinent pour appréhender la problématique, plaçant ainsi les faits empiriques dans un contexte de signification éclairant. Cette démarche théorique offre une grille d’analyse cohérente, permettant de relier les orientations des politiques publiques aux dynamiques sociales observées, tout en rendant intelligible l’articulation entre prescriptions institutionnelles et pratiques sociales effectives.
Enfin, au troisième chapitre, l’auteur propose un état des lieux analytique du contexte socioéconomique de la République Démocratique du Congo, où se déploient les politiques publiques inspirées par les institutions de Bretton Woods. Cette mise en perspective intègre l’examen systématique des secteurs socioéconomiques et des paramètres démographiques, révélant la complexité des structures et dynamiques qui influencent la formulation et l’impact de ces politiques. En combinant analyse des ressources, rapports de pouvoir et facteurs démographiques, l’auteur offre une lecture fine des interactions entre contraintes structurelles, choix politiques et expériences vécues par les populations, permettant ainsi de comprendre les effets contrastés des interventions internationales sur le développement de la RDC et le Bien-être des congolais.
Dans la seconde partie de son ouvrage, l’auteur nous invite à une plongée critique dans l’univers des politiques publiques ultralibérales : privatisations tous azimuts, réductions drastiques des dépenses sociales et ouverture des marchés à qui mieux mieux pour favoriser l’exportations, renforcer l’extraversion et consolider la présence des multinationales. Comme un sociologue en chef d’orchestre, il met en lumière l’écart saisissant entre le grand discours des institutions financières internationales et la réalité vécue sur le terrain, offrant ainsi des pistes pour des solutions pragmatiques, loin des slogans et des chiffres ronflants. Ainsi donc :
Au quatrième chapitre, il dévoile les coulisses de sa méthodologie : questionnaires, entretiens semi-directifs, observations et analyses documentaires s’entrelacent pour produire une symphonie de données fiables. La dialectique entre politiques publiques et conditions de vie des populations congolaises devient alors palpable, et l’on découvre avec un certain plaisir intellectuel comment rigueur et sensibilité peuvent cohabiter dans un même travail.
Le cinquième chapitre fait entendre les voix trop longtemps étouffées : fonctionnaires, enseignants, infirmiers, petits commerçants et acteurs de la société civile. Le constat est sans appel : ce que les rapports officiels présentent comme des succès économiques peut se traduire, dans la vie quotidienne, par des régressions douloureuses pour les citoyens. Un véritable décalage entre le papier glacé et le vécu des Congolais.
Enfin, le sixième chapitre se penche sur le sens sociologique des résultats et propose un modèle économétrique novateur pour analyser la complexité des effets des politiques publiques. L’auteur esquisse également un modèle théorique et paradigmique, avec l’ambition d’endogénéiser un système de gouvernance et de développement adapté à la RDC. L’ouvrage se clôt ainsi sur une note d’espoir lucide : malgré les contraintes et les dérives, il est possible de conjuguer analyse scientifique, pertinence sociologique et vision stratégique pour réinventer les politiques publiques et améliorer la vie des populations.
En somme, ce livre n’est pas seulement un outil d’analyse critique, il est aussi un manifeste citoyen, invitant à regarder au-delà des rapports officiels et à écouter ceux que l’on n’entend jamais. Un cocktail de rigueur scientifique et d’intuition sociologique, servi avec élégance et, parfois, une pointe d’humour salutaire.
- Apport du livre
Ce livre se distingue par un double apport :
- Scientifique, d’abord : l’auteur adopte une approche rigoureuse, combinant données empiriques, analyse documentaire et concepts sociologiques. Il propose une lecture critique mais équilibrée, qui évite aussi bien la diabolisation simpliste que l’acceptation aveugle.
- Citoyen, ensuite : cet ouvrage redonne la parole aux Congolais, ceux qui subissent les politiques publiques sans en être les concepteurs. C’est une invitation à réinventer la gouvernance économique, non plus seulement “pour” la population, mais avec elle.
C’est une radiographie d’un pays sous traitement, mais qui ose demander au médecin : « Docteur, ce médicament, est-ce qu’il est vraiment bon pour moi ? ». Car, depuis 60 ans que je le prend, mon état ne change pas et la douleur semble augmenter
- Conclusion « mobilisatrice »
Mesdames et Messieurs,
Ce livre ne se contente pas de dénoncer ; il appelle à repenser. Il ne rejette pas la coopération internationale ; il demande qu’elle soit juste, équilibrée, respectueuse de la souveraineté et des réalités locales. Au lieu d’être un “patient obéissant”, la RDC aspire à devenir un “partenaire exigeant”.
Il nous rappelle que le développement n’est pas une équation comptable : c’est une équation humaine. Et qu’aucune politique publique, aussi techniquement parfaite soit-elle, ne peut réussir si elle ne s’enracine pas dans la dignité et les besoins réels de la population. Car le développement ne se décrète pas à Washington, il se construit à Kisangani, à Kananga, à Matadi. Il ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en sourires retrouvés, en écoles remplies, en hôpitaux qui soignent vraiment.
En présentant cet ouvrage aujourd’hui, nous posons un acte citoyen et scientifique. Et nous espérons qu’il ouvrira un dialogue fécond entre décideurs, chercheurs et partenaires au développement — non pas pour accuser, mais pour construire.
Et si, après cette présentation, nous repartons avec une seule question à l’esprit, ce serait celle-ci :
« Et si, pour la première fois, nous écrivions ensemble — Congolais, partenaires, décideurs, chercheurs — un programme économique où le mot “population” ne serait pas qu’un chapitre, mais le cœur du projet ? ».
Et, comme dirait l’humour congolais : “Si ce livre ne change pas le monde… au moins, il changera quelques esprits, et c’est déjà un bon début !”
Je vous remercie.